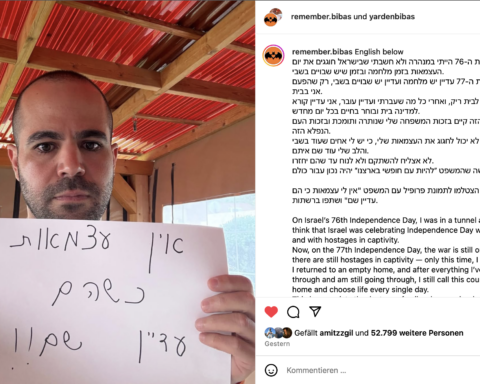Par Katharina Höftmann – Traduction : Jeannette Milgram
Il m’arrive de me demander comment ce serait de vivre en Allemagne. Pendant des vacances d’été, le hasard a voulu que j’habite juste en face de ma meilleure amie qui vit à Berlin avec son mari et son enfant. Nous avions rendez-vous un soir et je lui ai envoyé un message : ‘Je pars maintenant’. Deux minutes plus tard je sonnais à sa porte et elle me reçut en disant : « Oh, tu as fait vite. Tu t’imagines si tu vivais ici pour toujours ? ».
J’aime l’Allemagne ou, pour être précise, j’aime l’endroit où une grande partie de ma famille et un grand nombre de mes amis vivent. J’aime le lieu où je parle ma langue maternelle et qui me permet d’écrire des livres et de vivre de ma plume. J’aime le lieu dont non seulement je comprends les symboles culturels mais dans lesquels je me reconnais. J’aime le lieu auquel j’appartiens toujours, où je fais partie de la majorité et qui, même si je me sens complètement chez moi en Israël, est ma patrie. J’aime Berlin et son côté débridé ainsi que tous les souvenirs liés à cette ville. Et j’aime la mer Baltique, cette mer qui n’en est pas vraiment une, cette mer glaciale où pullulent les algues, que je porte depuis toujours et pour toujours dans mon cœur. Et alors il m’arrive de penser : ‘Ce serait comment si nous vivions en Allemagne ? Dans ma patrie ?’
Je connais toute la palette de l’antisémitisme allemand
J’y pense tout en sachant qu’entre l’Allemagne et moi quelque chose s’est cassé. A l’époque déjà, quand mon mari et moi vivions à Berlin, entre 2007 et 2010, nous étions constamment confrontés à l’antisémitisme : celui de la droite, de la gauche, celui des universitaires, des ouvriers du bâtiment, des Chrétiens, des Musulmans et celui de ceux qui ne croyaient plus en un quelconque Dieu depuis longtemps. Quand mon mari ne revenait pas en temps et en heure de la synagogue après les prières de Yom Kippour, je l’imaginais gisant quelque part car il avait été battu à cause de la kippa qu’il portait. Depuis que je connais mon mari, depuis que j’ai goûté à l’arbre de la connaissance, depuis que je ne regarde plus mon pays avec les mêmes yeux, je ne vis plus dans l’illusion qu’une vie juive normale est possible en Allemagne.
J’ai grandi à l’Est. Lorsqu’en 1992 le feu a été mis à la résidence Tournesol à Rostock-Lichtenhagen, j’habitais à quelques rues de cette barre d’immeubles. J’ai grandi dans des villes où les crânes rasés (c’est le nom que nous donnons aux néo-nazis) font partie du paysage. Ma mère les a eus dans sa classe et ils nous pourchassaient l’après-midi après le lycée. Et je me suis souvent trouvée au milieu de ces crânes rasés en allant voir un match de foot ou pendant les fêtes portuaires. J’ai grandi dans une ville qui a une ‘rue des Juifs’ mais qui ne compte plus aucun Juif. Dans une ville où le mot « Juif » sonne comme une insulte et où il est normal d’appeler les Asiatiques des « Niakoués » et les Noirs des « Bamboulas ». Depuis mon enfance, je connais la droite, également la droite bourgeoise des avocats et des médecins. Je connais la gauche et son antisionisme aigu depuis l’année de mes 19 ans, quand je me suis installée à Berlin. Je connais toute la palette de l’antisémitisme allemand et, ‘grâce’ aux colocataires palestiniens que j’ai fréquentés pendant mes études, je connais aussi la haine des Musulmans à l’égard des Juifs.
Et malgré tout, je ne puis m’empêcher de penser de temps en temps : Comment cela serait-il de vivre dans ma patrie ? D’enseigner sur place ma langue, ma culture, Goethe, Schiller et Schubert à mes enfants ? De déambuler avec eux dans des librairies allemandes, de se promener avec eux dans des forêts allemandes, de leur donner quelque chose qu’ils n’auront jamais en Israël. Je ne puis m’empêcher d’avoir de temps en temps le mal du pays, de ressentir le besoin de m’y rendre, un besoin aussi aigu que celui de respirer pour une personne restée longtemps sous l’eau. En dépit de mon amour profond pour Tel-Aviv, dès que j’arrive à Berlin, à la descente même de l’avion, je respire profondément et me sens chez moi. Malgré tout.

En sortant de la synagogue à la fin de Yom Kippour nous avons rallumé nos téléphones et j’ai pris connaissance de l’attentat à Halle. J’ai lu qu’un néo-nazi avait essayé d’entrer dans une synagogue et que, n’y parvenant pas, il avait exécuté au hasard deux passants. Mon mari, qui ne connaît que les mesures de haute sécurité devant les synagogues berlinoises, m’a demandé, incrédule, si la police ne surveillait pas la synagogue de Halle. Quand je lui ai répondu que dans la plupart des villes, notamment dans l’Est de l’Allemagne, il n’y a aucun policier devant les synagogues, il a secoué la tête et ses yeux m’ont envoyé le message suivant : « plus jamais je ne vivrai en Allemagne ».
Il a raison. Il faut soit montrer patte blanche à des policiers lourdement armés pour pouvoir prier à Yom Kippour, le jour où nous allons toujours à la synagogue, soit prendre le risque d’une attaque terroriste. Et même si Yom Kippour ne revient qu’une fois par an, le prix à payer est trop élevé pour lui. Et il ignore ce que je sais, moi : que c’est illusoire de croire que les Juifs pourront jamais mener une vie normale en Allemagne et que – ce qui peut sembler paradoxal à de nombreux Allemands – nous sommes bien plus en sécurité en Israël. En effet, indépendamment des critiques que l’on peut et doit émettre à l’encontre de la politique israélienne, ici nul ne se voile la face et chacun sait qui est l’ennemi, de quoi il est capable et comment s’en protéger. Ici chacun sait ce que peu d’Allemands ont compris jusqu’ici : que Halle est partout.