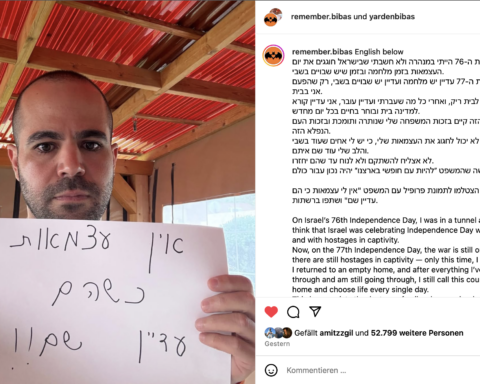Je dois à la vérité de dire que les écrivains et les journalistes éprouvent une véritable fascination pour les drames et les situations exceptionnelles. C’est évidemment la vie qui écrit les meilleurs scénarios et plus la période est grave ou exaltante, plus il y a matière à écrire. Nous entamons la quatrième semaine de confinement en Israël et mon humeur est globalement bonne, même si nous n’avons pratiquement plus le droit de sortir sinon dans un périmètre de 100 mètres autour de notre logis, même si les sorties – quand on se risque à quitter son logement – ont un air de fin du monde (Tel-Aviv est devenue une ville fantôme et les rares personnes qu’on peut voir portent presque toutes un masque et changent de trottoir plutôt que de croiser le moindre passant). Même si je n’arrive pratiquement plus à écrire (avec deux enfants de trois et cinq ans, le calme nécessaire à l’écriture est un rêve inaccessible), je collectionne dans ma tête des histoires, des instants, un ressenti, en espérant pouvoir un jour, quand ce cauchemar sera terminé, les coucher sur le papier.
Le problème est de savoir quand l’épidémie prendra fin. Pour moi, chaque situation, y compris le confinement, y compris l’épidémie de coronavirus qui est, de par son ampleur, la crise mondiale la plus grave depuis la fin de la guerre 39-45, est supportable si je peux envisager que je verrai à un moment la lumière au bout du tunnel. Mais la question est : la verrai-je ? Et dans l’affirmative, à quoi ressemblera la vie après ? Quand pourrons-nous de nouveau aller danser, voyager en toute insouciance et serrer la main des gens ? Pour l’instant, je ne sais même pas quand je reverrai mes parents et mes amis en Allemagne.
D’accord il ne s’agit pas d’un conflit armé. Nous devons simplement rester à la maison. C’est tout. Et ce ralentissement de notre mode de vie a aussi du bon. J’ai un toit sur la tête que je partage avec les trois personnes que j’aime le plus au monde, et nous faisons en sorte que la cohabitation soit la meilleure possible. Toutefois, et c’est un toutefois que j’écris en majuscules, certains jours je me sens vraiment mal. Je me sens prisonnière, j’ai l’impression qu’on me vole ma vie. Je me remémore les soirées avec des amis au restaurant, les voyages en famille dont nous parlons encore aujourd’hui, et j’ai un gros pincement au cœur. On pense que tout est un dû, que la liberté de se mouvoir est quelque chose de normal et voilà qu’un virus balaie toutes nos certitudes.
Mercredi soir 8 avril, nous fêterons pessa’h qui célèbre la sortie d’Egypte des Hébreux qui y étaient tenus en esclavage mais cette année le seder, qui est le repas traditionnel, se tiendra en tout petit comité avec juste les membres de la maisonnée. Alors que normalement toute la famille est réunie, soit une vingtaine de personnes, nous ne serons que quatre cette fois. Et la liberté ultime sera de se rendre préalablement au supermarché, le seul lieu éloigné de plus de 100 mètres de notre habitat qui soit autorisé. Que le Shufersal de la rue Ben Yehuda puisse devenir mon refuge, que le trajet pour s’y rendre en longeant les petites rues étroites de Tel-Aviv, en passant devant l’ambassade du Sri Lanka et devant l’estaminet où, à l’ombre des ficus géants, nous sirotions parfois un verre de vin, soit devenu l’incarnation de la liberté me semble surréaliste. Cent mètres et plus…. En route vers un supermarché qui maintenant représente l’ouverture au monde. Drôle de liberté que cette nouvelle liberté.